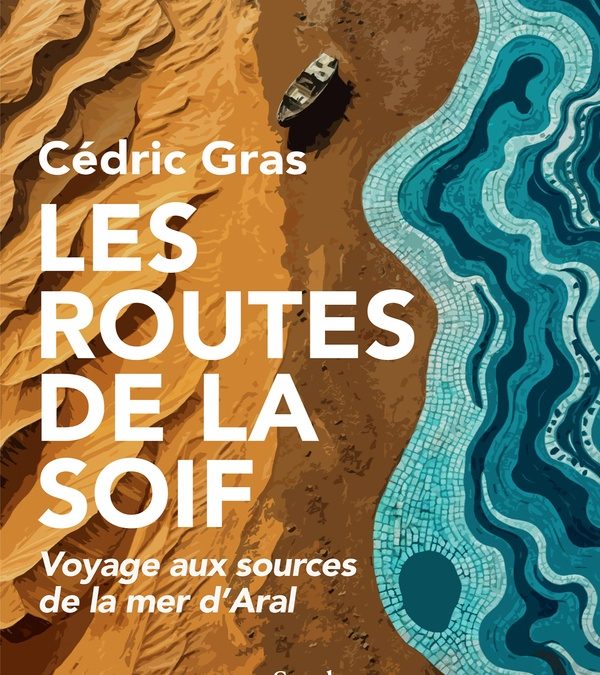Dès les premières phrases, le ton est donné, le décor posé : une route cabossée, des passagers ensommeillés, des pêcheurs clandestins s’échappant dans la nuit au bord de ce qui reste de la Mer d’Aral, côté Kazakhstan. Cédric Gras nous embarque d’emblée pour une longue traversée des steppes de l’Asie Centrale jusqu’aux glaciers du Pamir. Nous voilà plongés au cœur de paysages aussi éblouissants qu’inhospitaliers, d’enjeux économiques, géostratégiques, humains. Son œil de géographe, son expérience de l’Eurasie, sa plume l’inscrivent dans une lignée d’écrivains-voyageurs. « Un voyage à rebours, d’une mer disparue à sa genèse glaciaire » remonte ce qui était le delta du fleuve Amou-Daria jusqu’à ses sources himalayennes.
Un voyage de sourcier
Le périple, long de 2800 kms, est d’abord observation du scientifique, « une quête des eaux, un voyage de sourcier ». Depuis les années 1960, la Mer d’Aral ne cesse de s’évaporer. Elle a disparu à 90% aujourd’hui. Son assèchement tient à l’épuisement de l’Amou-Daria, l’immense fleuve endoréique [1], pompé pour l’irrigation des pays arides qu’il traverse. Il finit là, fantomatique. Toute l’Asie Centrale, aux plaines nues et sans nuages, est quadrillée de canaux dérivant ses eaux. « Une vraie plomberie à ciel ouvert » assure cultures et autonomie économique de ces ex-républiques soviétiques. A Moynaq, qui fut le port le plus florissant de la mer d’Aral, « les dernières carcasses [des grands chalutiers de pêche] gîtent dans les dunes de sable », décor apocalyptique pour touristes et influenceurs. Puis les noms s’égrènent, parmi les contrées les plus hostiles de la terre. Nous apprenons de ce voyage les noms de capitales inconnues, Noukous, celle du Karakalpakstan, Kiptchak, où il pleut une fois par an, les oasis agricoles comme celle d’Ourguentch où le fleuve n’est plus qu’un entrelac de bras au milieu des champs de coton et de riz. En Ouzbékistan, la route toute droite nous donne avec lui « un vertige horizontal dans le vide du pays ». Nous sommes confrontés à l’hermétisme du désert de Karakoum et surtout du Turkménistan qui l’abrite. Pays de dunes et de pierrailles, il recèle d’immenses champs de gaz. Nous nous habituons peu à peu à un vocabulaire, des orthographes inaccoutumées. Nous nous nourrissons de langman et de plov, de chachliks, au milieu des saxoubs plantés par milliers et des barkhanes [2].
Après avoir passé tous les barrages policiers de ces pays loin d’être émancipés des pratiques anciennes, pointe la frontière afghane. Le voyage se poursuit côté Tadjikistan. Il touche à son but pour ces alpinistes chevronnés, qui ont « bouffé du désert » pendant de longs mois : explorer le 3e pôle, les glaciers de l’arc himalayen, ses torrents tumultueux à traverser, le barrage de Nourek à atteindre, longtemps le plus haut du monde. L’Amou-Daria n’est plus que sources multiples. La fonte du plus long glacier du monde, le Fedchenko (77 kms), les alimente. Depuis la vallée du Bakhtang, dans un autre désert, minéral celui-là, de longs jours de marche les attendent, sur une piste bordée de précipices. « Aucun sentier, aucun repère, aucune trace humaine ». Au 8e jour, le plateau glaciaire offre ses paysages éblouissants. Le but atteint, « Tout le monde est serein. C’est un aboutissement pour tous ». Le récit s’achève là, net.
Une actualité brûlante
Mais il va bien au-delà. A travers cette expédition, Cédric Gras, accompagné du réalisateur de documentaires Christophe Raylat, « prend le pouls du monde ». Il questionne et documente des thématiques d’une actualité brûlante. « Nous remontons la piste de l’eau, la filière de la soif, l’origine de la vie ». Ces républiques riveraines, englobées dans l’URSS, n’étaient point rivales. Complémentaires, elles s’échangeaient les denrées. Aujourd’hui concurrentes, elles mènent une lutte pour leur survie. Mais leur coton et leur riz pousse au détriment de tous ceux en aval d’eux. Inquiétude de tous aujourd’hui, l’Afghanistan construit aussi en amont son canal, de Qash Tepa, pour se préserver des famines. Une guerre de l’eau est possible, une catastrophe écologique est certaine. Le sel imprègne les sols, lessivés … à grandes eaux pour répandre pesticides et fertilisants de synthèse.
Dès le protectorat russe fin XIXe siècle, les tsars pensent à inonder les steppes. Les Soviets (plan Staline puis Khrouchtchev) l’ont fait. Ils ont même songé à ensemencer les nuages pour faire pleuvoir. Tous les grands projets hydrauliques sont despotiques, dans l’histoire humaine.
Le sens du voyage
Un doute s’insinue chez Cédric Gras sur l’intérêt de ses observations : « Pour être honnête avec soi-même, voyager ne procure que peu de réponses sans documentation annexe, préalable ou consécutive ». Pourtant, il nous renseigne directement depuis le terrain sur les (dés)équilibres de cette région, qui forme un véritable continent intérieur à l’Asie. Il documente ses républiques autoritaires, la présence policière partout, les Chinois aussi, et un formidable matériau : l’humain, donnant parole et corps à ses interlocuteurs, d’Ali à Rafsan, jusqu’à Anatoli, guide des glaciers.
Son doute sur le sens du voyage se renforce au vu du tourisme de masse qui progresse, notamment en Ouzbékistan. Quelle part les explorateurs ont-ils pris, ouvrant la voie ? Khiva, Boukhara, fournissent des « décors de rêve pour touristes 5.0, « en voie de folklorisation avancée » ployant sous les souvenirs camélidés et les hôtels-caravansérails.
Le voyage à rebours, de la mer aux origines, se voulait à l’écart justement de ces routes touristiques empruntant les pas de Marco Polo. Pourtant, l’auteur est lui aussi saisi par les vestiges d’une histoire très ancienne, multiculturelle, jusqu’à très contemporaine, de ces contrées.
Il rallie « les mythiques cités ». Khiva, à la frontière turkmène, se dresse à l’intérieur de ses remparts de boue séchée. Rasée par Gengis Khan, plaque tournante du commerce d’esclaves au XVIe siècle, ses céramiques murales, ses dômes, sa medersa subjuguent tout visiteur par leur éclat. Cédric Gras n’atteindra par Merv contemplée par Alexandre le Grand, et ses cités enfouies, rasées par les Mongols. Arrêté par la police au Turkménistan, il poursuit quand même jusqu’à Turkmenabat, où il retrouve l’Amou-Daria, « frontière mythique entre les mondes antiques ». Côté ouzbek, Boukhara prospère aujourd’hui au milieu des champs de coton et des vergers. Là encore, la beauté des lieux, la richesse des dynasties (hellénistiques, perses, turques) qui s’y sont succédées le captivent.
Dans la région de Bactriane, se dessinent les premiers reliefs et l’Amou-Daria retrouvé. « C’est le fleuve originel, presque sauvage, qui coule sous nos yeux, tel que l’a contemplé Alexandre le Grand » qui y épouse Roxane. Termez, « cette lisière d’empires » à la frontière de quatre pays actuels fait rêver tout voyageur[3]. Et Cédric Gras de lâcher, comme un aveu : « Qui n’est pas fasciné par l’épopée des steppes, les batailles homériques, les terres abreuvées de plus de sang que d’eau ? les rives de l’Amou-Daria sont hantées de civilisations perdues ». Marco Polo, dont l’ombre tutélaire plane aussi sur ce périple, a été le premier à passer dans le massif du Pamir, dans cette vallée resserrée de défilés étroits. « Le regard perdu et le soir tombant, je crois un instant le voir cheminer sur une sente aérienne ».
Une vision
Matthieu Tordeur, jeune aventurier polaire, rejoint l’expédition au Tadjikistan. Il propose de faire des stories sur Instagram, « c’est plus dans les livres que ça se passe aujourd’hui (…) Ce sur quoi il n’a pas tort ». Mais aucun instagrameur ne saisira une photo, une story de 2800 kms de long, 248 pages, des centaines de personnes rencontrées, des saxoubs et des barkhanes, des glaciers géants en figurants. Magie de la plume, elle fixe tout cela en une seule vision. Là-haut, « des rougeurs éphémères embrasent les mosaïques de séracs. L’ombre grignote peu à peu les dernières flèches dorées par le couchant ». Souhaitons avec lui une nouvelle aube. Car l’Amou-Daria, un des quatre fleuves du Paradis selon le géographe Ibn Battûta, pourrait bien se tarir aussi avec le réchauffement climatique. L’enfer est à ses portes.

Cédric Gras, Les routes de la soif, Stock, 2025
Il a reçu le prix Albert Londres du livre pour Alpinistes de Staline (Stock, 2020)
Cette chronique a paru sur le Blog du Festival des Automn’Halles de Sète le 14 mars 2025 sous le lien suivant: https://www.lesautomnhalles.fr/les-routes-de-la-soif-de-cedric-gras
[1] Endoréique, l’Amou Daria se jette dans les terres, la mer d’Aral étant une mer fermée
[2] Langman : soupe de grosses nouilles servies partout en Asie Centrale ; plov : riz, carottes et coriandre ; chachlik : brochette de viande marinée ; saxoub : buisson poussant dans la steppe ; barkhane : dune de sable
[3] Ouzbékistan, Afghanistan, Turkménistan, Tadjikistan